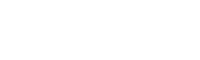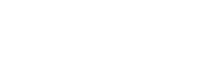Destinations au banc d'essai
Doing Business : ce qu’il faut savoir avant de se lancer
Dans les pays du Golfe, les réformes structurelles dans le domaine fiscal se sont accélérées. Des décisions qui interviennent dans un contexte de diversification économique, mais également d’alignement sur les normes internationales de transparence et de conformité.

Les États du Golfe, longtemps dépendants des hydrocarbures – qui représentaient encore 70 % des recettes budgétaires saoudiennes en 2023 – cherchent de nouvelles ressources face à la volatilité des cours du pétrole. Depuis 2018, la quasi-totalité d’entre eux ont introduit une TVA à 5 %, à la suite d’un accord signé en 2016 par les 6 pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Cette TVA a parfois été ajustée selon les besoins : ainsi en 2020, l’Arabie saoudite a relevé son taux à 15 %, afin de financer de grands projets. Au Qatar, la loi sur la TVA a été promulguée en 2018 mais n’est pas encore entrée en vigueur et au Koweït, son introduction ne cesse d’être repoussée.
Petit à petit, depuis 2017, tous les pays, à l’exception du Qatar, ont également introduit des droits d’accises allant de 50 % à 100 % sur un certain nombre des produits, principalement sur le tabac et les boissons.
Bahreïn, premier pays du Golfe à instaurer une taxe sur les multinationales
Rendus célèbres pour leurs régimes fiscaux avantageux, les Pays du Golfe ont entamé une importante mutation. Des impôts sur les sociétés ont ainsi vu le jour. Cette taxation sur les entreprises s’élève à 9 % aux Émirats depuis 2023, 10 % au Qatar, et jusqu’à 15 % en Arabie saoudite, en Oman et au Koweit. Mais Bahreïn a créé la surprise en septembre 2024 en devenant le premier État du Golfe à imposer directement les multinationales, avec un taux minimum de 15 % pour celles dont le chiffre d’affaires mondial dépasse 750 millions d’euros. Une rupture dans une région historiquement attractive fiscalement, et où la fiscalité des entreprises restait quasi inexistante. Sandrine Lescaroux, directrice générale de la CCI France Qatar, remarque ainsi que « la fiscalité n’est plus l’argument principal pour venir dans le Golfe : les investisseurs regardent désormais la taille du marché, la stabilité des règles et les infrastructures ».
L’initiative bahreïnie s’inscrit aussi dans le cadre de l’accord international piloté par l’OCDE, adopté par plus de 140 pays, qui vise à fixer un impôt minimal mondial pour limiter la concurrence fiscale. Pour le royaume, cette mesure répond autant à des impératifs budgétaires pressants qu’à une volonté de renforcer sa crédibilité internationale, dans un contexte régional instable.
Si Bahreïn fait figure de pionnier, ses voisins restent prudents. Les Émirats ont commencé à adapter leur législation, tandis que le Koweït a rejoint en 2023 le cadre de coopération de l’OCDE. Reste à voir si l’initiative bahreïnie servira d’exemple et accélérera le virage fiscal des autres monarchies du Golfe.
L’essor des zones franches, el dorado des entreprises
Il existe cependant des possibilités pour bénéficier de taux réduits ou d’exonération, notamment par l’implantation dans les Zones Economiques Spéciales ou Zone Franches. Il est donc possible d’échapper à certaines taxations en immatriculant son entreprise dans l’une de ces zones. Il faut alors bien souvent exercer dans le périmètre de la zone et respecter un cahier des charges précis. La plus connue d’entre elles est sans conteste la zone franche Dubaï Multi Commodities Centre, qui regroupe plus de 24.000 entreprises.
C’est d’ailleurs aux Emirats Arabes Unis que la première zone franche du Golfe a été établie, en 1985. Aujourd’hui, le pays est constellé de zones de ce type : il en compte aujourd’hui 46. Les États voisins se sont depuis emparés de cet outil très incitatif pour l’implantation d’entreprise. Dans un contexte de compétition régionale, l’Arabie Saoudite a ouvert ses 4 premières zones franches en 2023. En misant sur une approche sectorisée, la monarchie permet le développement d’un écosystème au sein de ces zones. Ainsi, quand l’une est accès MedTech, la 2e est sur l’agroalimentaire, la 3eme sur le naval et la dernière est tournée vers les sujets de cloudisation des données. Cependant, Guillaume Rebière, président du Conseil d’Affaires Franco-Saoudien met en garde : « Les zones franches sont des sas d’entrée, mais la vraie relation de confiance se noue quand l’entreprise installe son siège dans le pays, au cœur du marché ». Une vaste politique de relocalisation des sièges d’entreprises a d’ailleurs été entreprise par la monarchie depuis 2021. Cette démarche connaît un grand succès.
Plus modestement, le Qatar, Oman et Bahreïn compte deux zones franches et le Koweït, une seule.
Politiques de nationalisation de l’emploi
Parmi les évolutions notables, celle-ci traduit illustre bien que la libéralisation de ces économies est en marche : les étrangers peuvent par principe s’installer seuls, sans actionnaire local, dans la plupart des secteurs et au-delà même des zones franches. Les législations sur l’investissement direct étranger ont évolué très vite, et simultanément. Seul le Koweït reste attaché à la règle des 51/49, qui impose un actionnariat local majoritaire.
Les Pays du Golfe sont de plus en plus pointilleux, en revanche, sur la préférence à l’embauche locale. La volonté de « nationaliser » les emplois et de réduire la dépendance à la main-d’œuvre étrangère est ancienne, mais connaît une intensification ces dernières années. Au lendemain du premier choc pétrolier dans les années 1970, ces monarchies peu peuplées ont massivement fait appel à des travailleurs immigrés, qui représentent aujourd’hui la majorité de la population dans le Golfe, environ 70 %.
Pour permettre l’emploi d’une main d’œuvre jeune et en forte croissance (ainsi en Arabie saoudite, 61% de la population a moins de 30 ans), plusieurs pays ont développé des politiques de quotas. On parle alors de « saoudisation », d’« omanisation », d’« émiratisation » etc, du travail. Ces quotas consistent en l’obligation, pour les entreprises, de compter dans leurs effectifs un pourcentage défini de ressortissants locaux. En cas de non-respect des règles, la sanction, aux Emirats par exemple, est une amende d’un peu moins de 20 000 dollars par an (pour une entreprise de plus de 50 salariés devant recruter 2% d’émiratis). Les entreprises s’exposent également à l’impossibilité de renouveler leurs visas et à une rupture de communication avec les administrations des États. Marie de Foucauld, membre de la Saudi Fashion Commission, estime que le premier enjeu des entreprises étrangères est de « s’intégrer dans la dynamique locale : il ne s’agit pas seulement de cocher une case pour les quotas, mais de comprendre la logique de long terme. Créer des compétences, s’ancrer dans le pays ». Cette politique des quotas permet, finalement, de challenger la volonté des entreprises à s’installer durablement dans le Golfe.
Certains postes sont également réservés aux citoyens locaux, à divers degrés et dans divers secteurs. Des listes sont mises à jour régulièrement par chacun des états. Au fil du temps, elles s’étoffent : la jeunesse locale est de plus en plus formée et qualifiée et le besoin de main d’œuvre occidentale recule. Agnès Lopez Cruz, directrice de la CCI France EAU le confirme : « On assiste à l’émergence d’une génération très bien formée, qui a étudié à l’étranger et parle anglais. Les entreprises n’ont plus d’excuses pour ne pas les recruter »
La concurrence dans les Pays du Golfe est de plus en plus féroce, avec l’entrée dans la danse de mastodontes (Chine, Etats -Unis, Inde, entre autres). Aller entreprendre dans les Pays du Golfe ne s’improvise plus, si tant est que ce fût le cas un jour. Mais avec une bonne préparation, un réel intérêt pour le pays et un réseau actif, toutes les success story sont possibles.
> Les règles d’or pour une bonne implantation
- Préparez une offre claire, compétitive et localisée pour les entrepreneurs, décrocher une embauche avant le départ ou entamez sérieusement les négociations
- Anticipez les formalités : visas, licences commerciales, règles du travail et fiscalité (zones franches, TVA selon les pays).
- Soyez prêt à investir du temps sur place : réseauter physiquement reste la clé, les rencontres informelles comptent beaucoup.
- Inscrivez-vous au registre consulaire : utile pour les démarches, la sécurité et le vote.
- Rejoignez les relais locaux : Chambre de commerce française locale, UFE, Business France, et les groupes francophones (Facebook, WhatsApp). Ces réseaux ouvrent des portes et offrent du parrainage.
Ce mois-ci, le dossier de Français à l’étranger est consacré aux pays du Golfe. Entre zones franches, réformes ambitieuses et projets comme « Vision 2030 », nous explorons l’attractivité de la région avec analyses, témoignages et conseils pratiques. Des articles à retrouver chaque jour, à l’occasion du GCC France Business Forum, organisé à Dubaï sous l’égide de CCI France International le 23 octobre.
- Le Golfe, à l’heure du grand rééquilibrage
- Doing Business : ce qu’il faut savoir avant de se lancer
- Témoignages : Ces Français qui ont lancé leur entreprise à Dubaï, Doha ou Riyad
- Travailler dans le Golfe : quelles opportunités pour les cadres et experts français ?
- S’installer dans le Golfe : à quoi s’attendre quand on est Français
- Accélérer sa réussite dans le Golfe avec Business France
- Statuts, visas et régularisation : ce qui a changé
- GCC–France Business Forum : la communauté française du Golfe s’affiche
- Les Français du Golfe : une diaspora discrète mais influente
- CCI, Business France, clubs d’affaires : les relais pour bien s’implanter dans le Golfe

 Nos partenairesil y a 6 jours
Nos partenairesil y a 6 joursScolariser ses enfants à Panama

 Nos partenairesil y a 2 semaines
Nos partenairesil y a 2 semainesBien choisir son programme post-bac à l’IÉSEG : Bachelors ou Grande École ?

 Vie pratiqueil y a 6 jours
Vie pratiqueil y a 6 joursFrance Consulaire : un numéro disponible désormais dans le monde entier

 Vie pratiqueil y a 4 jours
Vie pratiqueil y a 4 joursEnfants d’expat : le déracinement à l’âge adulte est-il inévitable ?

 Webinairesil y a 2 semaines
Webinairesil y a 2 semaines[Vidéo] Private equity : des fonds rigoureusement sélectionnés, accessibles aux expatriés

 Actualités internationalesil y a 2 semaines
Actualités internationalesil y a 2 semainesDu changement en tête des meilleurs pays où s’expatrier

 Etudier et travailleril y a 4 semaines
Etudier et travailleril y a 4 semainesSuisse : quand les Français plient bagage à cause du chômage
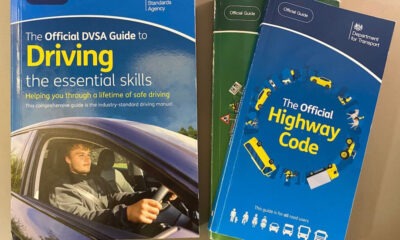
 Vie pratiqueil y a 1 semaine
Vie pratiqueil y a 1 semaineComment passer son code de la route au Royaume-Uni ?