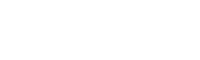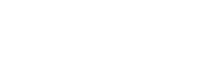Tribune
Quel avenir pour l’enseignement français à l’international : faut-il revoir le rôle de l’AEFE ?
Les résultats consolidés du baccalauréat français seront publiés dans les prochains jours. Déjà, plusieurs académies ont communiqué les résultats des centres d’examen à l’étranger. Beaucoup de familles françaises établies hors de France célèbrent donc, avec fierté, la réussite de leurs enfants.

À juste titre : si la tendance se confirme, le millésime 2025 devrait suivre les traces de 2024, qui avait vu 98,3 % de réussite au bac pour les élèves du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE), avec plus de 80 % de mentions, bien au-dessus de la moyenne nationale (91% de réussite).
Ces résultats impressionnants donnent, à première vue, le sentiment que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles pour l’enseignement français à l’étranger.
Effectivement, l’AEFE a connu une croissance importante en vingt ans : de 150 000 à près de 400 000 élèves entre 2005 et 2024. En 2018, le président de la République lui a d’ailleurs fixé l’objectif de doubler encore ses effectifs d’ici 2030 (soit 700 000 inscrits), via le plan stratégique Cap 2030. L’AEFE a su également accroitre largement son réseau (580 établissements dans le monde) en s’appuyant sur un grand nombre d’établissements partenaires privés.
Mais derrière ces succès se cachent des signaux faibles qui devraient nous alerter. Avant de s’engager « tête baissée » dans une nouvelle phase de croissance ambitieuse (et modérément réaliste au regard des contraintes budgétaires), une réflexion stratégique s’impose.
L’AEFE : une filière minoritaire pour la scolarisation des jeunes français de l’étranger
Mais si l’AEFE a massivement recruté, c’est surtout hors public français. Car, dans les faits, l’AEFE est une filière désormais nettement minoritaire pour les Français de l’étranger :
- En 2005, 44 % des élèves dans les établissements AEFE étaient français.
- En 2024, ils ne sont plus que 30 %, soit environ 120 000 élèves français sur près de 400 000.
- Aujourd’hui, plus de 240 000 jeunes Français de l’étranger sont scolarisés hors AEFE (écoles locales, internationales, CNED, etc.).
Une mission aux contours flous
L’AEFE remplit plusieurs fonctions : opérateur d’établissements en gestion directe, animateur de réseau, autorité d’homologation, accompagnateur pédagogique… Un cumul de rôles qui pose la question de la lisibilité – voire de la cohérence de sa mission. Est-elle là pour :
- Accompagner les parcours éducatifs des Français à l’étranger ?
- Promouvoir le rayonnement culturel et linguistique de la France ?
- Servir d’outil de diplomatie ou de soft power ?
- Contribuer à l’aide au développement dans certaines zones du monde ?
La réalité est probablement un peu de tout cela. Mais comme souvent, qui trop embrasse mal étreint.
L’AEFE consacre aujourd’hui plus de 70 % de ses dépenses aux seuls établissements en gestion directe, qui ne représentent pourtant que 12 % du réseau. Cette focalisation – notamment en Afrique francophone – contraste avec les forts besoins dans des zones en croissance rapide comme le Moyen-Orient ou l’Amérique du Nord. Ainsi l’Amérique regroupe 24% des Français de l’Etranger mais seulement 14% des Français scolarisés dans le réseau AEFE.
Cette situation génère des restrictions d’accès dans de nombreuses régions ainsi que des frais de scolarité très élevés malgré une subvention d’Etat à l’AEFE supérieure à 500 millions d’euros.
Que faire ? Trois propositions concrètes
- Organiser des États généraux de l’enseignement français à l’étranger, sur le modèle des Assises de la protection sociale de 2025 menée sous l’égide de l’Assemblée des Français de l’Etranger à l’initiative du gouvernement. Un diagnostic clair et collectif s’impose, avec les familles, les élus, les enseignants, les opérateurs.
- Recentrer l’AEFE sur son rôle d’animateur de réseau, en encourageant la montée en puissance du privé là où c’est pertinent. Le désengagement progressif de la gestion directe pourrait libérer des ressources pour mieux soutenir les familles françaises et le réseau conventionné et partenaire,
- Développer un véritable observatoire indépendant des parcours éducatifs des jeunes Français de l’étranger. Cela inclut une cartographie des systèmes hors AEFE (notamment LabelFrancEducation), des outils pour guider les familles dans les cursus francophones alternatifs, et une valorisation des bonnes pratiques pédagogiques à l’international. L’AEFE devrait être un pilote, un hub de connaissance, de coordination et d’influence, à moyen terme dégagé de son rôle d’opérateur.
Repenser la gouvernance
Enfin, il devient urgent de revoir la gouvernance de l’AEFE :
Un Conseil d’administration de 32 membres, dans lequel l’Assemblée des Français de l’étranger ne dispose que d’un siège… autant que le ministère de l’Intérieur ou que l’Agence Française de Développement (qui n’est compétente que dans un seul des 10 pays concentrant le plus de Français expatriés). Il est temps de donner plus de place aux familles, aux enseignants, aux élus de terrain pour recentrer l’Agence sur l’usager.
Nos enfants passent leurs examens. À nous de travailler.
Alors que nos enfants viennent de plancher sur leurs épreuves, il nous revient à nous – parents, responsables, élus – de retravailler le modèle éducatif français à l’étranger. Pour qu’il soit à la hauteur de leurs espoirs. Pour qu’il serve encore mieux les usagers. Pour que l’excellence française continue à briller… avec les Français de l’étranger au cœur du système et non en périphérie.
-

 Vie pratiqueil y a 1 semaine
Vie pratiqueil y a 1 semaineDéclaration de revenus française: attention, les envois scannés ne sont plus acceptés
-

 Etudier et travailleril y a 6 jours
Etudier et travailleril y a 6 joursEnvie d’ailleurs ? 10 métiers improbables (et presque introuvables en France) à tester dans une autre vie
-

 Etudier et travailleril y a 3 jours
Etudier et travailleril y a 3 joursBrexit : un impact énorme sur la mobilité étudiante au Royaume-Uni
-

 Actualités économiquesil y a 1 semaine
Actualités économiquesil y a 1 semaineCCI France International : le palmarès des Trophées 2025
-

 Portrait de la semaineil y a 1 semaine
Portrait de la semaineil y a 1 semainePodcast French Expat : « “Faire le bien, c’est plus dur que faire le mal”, retour sur 20 ans passés entre la France et le Brésil avec Cédric de Giraudy »
-

 Evènementsil y a 1 semaine
Evènementsil y a 1 semaine#ErasmusDays : Tout ce qu’il faut savoir sur l’édition 2025
-

 Etudier et travailleril y a 1 jour
Etudier et travailleril y a 1 jourNomades numériques : quels visas pour travailler en voyageant ?
-

 Portrait de la semaineil y a 2 jours
Portrait de la semaineil y a 2 joursPodcast French Expat : ≪ Vacances en France : envie ou corvée ? – un podcast qui met les mots sur le fameux dilemme estival ≫